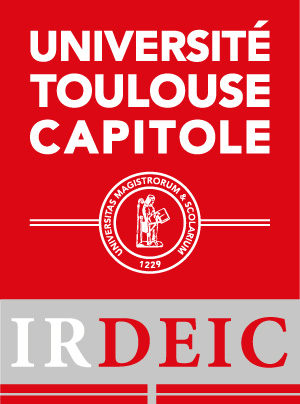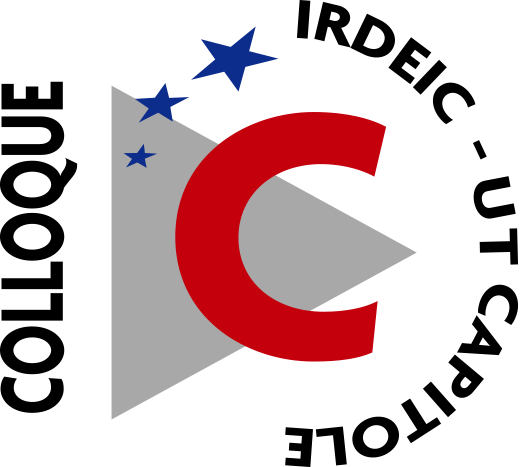Recherche
Colloque " La concentration des contentieux transfrontières " organisé par le DANTE (Université Paris-Saclay) et l'IRDEIC
Colloque " La concentration des contentieux transfrontières " organisé par le DANTE (Université Paris-Saclay) et l'IRDEIC
du 13 novembre 2025 au 14 novembre 2025
Bâtiment Rempart
Sous la responsabilité scientifique de :
Sandrine Clavel, Professeure à l'université Paris-Saclay, UVSQ, DANTE
Estelle Gallant, Professeure à l'université Toulouse Capitole, IRDEIC
Fabienne Jault-Seseke, Professeure à l'université Paris-Saclay, UVSQ, DANTE, Institut Universitaire de France
Présentation
La notion de concentration des contentieux en droit international privé n’a guère suscité d’études d’ensemble. Classiquement, on l’évoque à propos des règles de compétence dérivée : la concentration est alors perçue comme une faculté, assez strictement encadrée, pour le demandeur de présenter plusieurs demandes ou d’attraire plusieurs défendeurs devant un même juge national. Elle a également sa place dans les réflexions sur la reconnaissance des décisions lorsque l’on se penche sur l’étendue de l’autorité de chose jugée. Des affaires récentes l’ont rappelé. Sous cet angle, on s’interroge sur l’existence, pour les parties, d’une obligation de concentrer leurs moyens devant la juridiction originellement saisie.
La concentration des contentieux relève de la stratégie contentieuse et participe de l’efficacité de la justice.
D’un côté, l’objectif de concentration permet de faciliter les recours. Il oblige à les structurer pour éviter qu’ils ne soient multiples, redondants, et aboutissent à des solutions incohérentes. Derrière la notion de concentration transparaît ainsi l’idée de cohérence. Ce colloque s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des recherches menées par Fabienne Jault-Seseke dans le contexte de sa délégation IUF, dédiée aux modalités de la coopération des autorités tant judiciaires qu’administratives. Il constitue le prolongement des travaux menés dans le cadre d’un groupe de travail qu’elle a initié, consacrés à la cohérence des contentieux, groupe auquel plusieurs intervenants au colloque ont participé.
De l’autre, l’éclatement des contentieux procède parfois d’une véritable stratégie procédurale de la part des plaideurs, et au premier chef du demandeur. Il s’agit alors de mettre au service d’objectifs, qui peuvent être dilatoires (épuiser l’adversaire) aussi bien que fondamentaux (on peut songer par exemple aux contentieux des droits humains ou environnementaux), les options offertes par la diversité de fors, de règles procédurales et substantielles, mais aussi de politiques publiques. S’il faut certes veiller à enrayer les tactiques de harcèlement judiciaire pouvant être déployées par certains plaideurs peu scrupuleux, imposer une concentration systématique des contentieux peut aussi sembler une fausse bonne idée. Est-il possible de préserver une cohérence des contentieux, tout en ménageant une possibilité d’user du contentieux comme outil stratégique ?
L’équilibre, on le comprend, est délicat à trouver. Les facettes de la concentration des contentieux sont multiples. Le colloque s’efforce d’en donner une vision très large, quoique non exhaustive, en réunissant des spécialistes qui partageront leurs réflexions sur des sujets variés, se chevauchant parfois mais sous des prismes différents, afin de livrer in fine une pensée construite pour définir une position d’équilibre : pourquoi, comment, et jusqu’où concentrer les contentieux pour en assurer une cohérence bien comprise, sans sacrifier à d’autres objectifs substantiels ou processuels également légitimes ?
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Partenaires :
 |
 |
 |