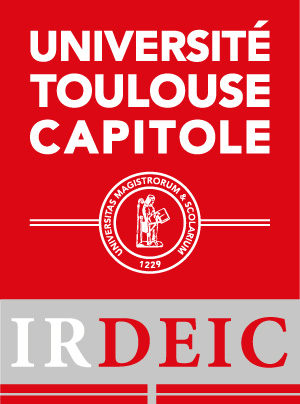Recherche
Anciens programmes
- EGERI – Etude de la gouvernance européenne des risques et santé publique
Le programme EGERI est consacré à la politique alimentaire de l’Union européenne et à la sécurité alimentaire, tout en prolongeant cette étude de la sécurité alimentaire en allant plus loin, sous plusieurs angles ou 4 volets :
- Étude de la sécurité alimentaire au niveau de l’action de l’UE
- Développer une approche comparatiste sur la gestion des risques spécialement en matière alimentaire
- S’intéresser plus largement à l’action de l’UE en matière de « sécurité »
- Dépasser la sécurité alimentaire pour s‘intéresser à la politique communautaire de la santé
Le programme a été mené par les Professeurs N. DE GROVE VALDEYRON et M. BLANQUET., en collaboration pour les deux premiers volets avec le Professeur R. OUELLET de l’Université Laval (Québec).
Il s’est conclu par de nombreuses publications, témoignage de résultats positifs, ainsi qu’une thèse en cotutelle avec l’Université de Montréal sur « L’analyse du risque dans le domaine du médicament : approche comparée en droit européen et en droit canadien ».
Le programme a permis de développer au sein de l’IRDEIC un pôle de compétence sur les questions de sécurité, et de se positionner comme un centre d’expertise en matière de droit communautaire et de politique communautaire de la santé, notamment avec une étude des interactions entre les objectifs économiques et les exigences de santé publique, la politique des médicaments et la libre circulation des patients. Il en résulte une reconnaissance tant nationale qu’internationale comme en témoignent les 2 communications collectives dans un colloque international au Québec, les 6 communications dans un colloque international (Bruxelles, Montréal, Milan), et les diverses publications, communications et participations à des ouvrages collectifs nationales et internationales qui en ont résulté.
- PRAGUE– Agece de l'Union Européenne
Reposant sur l’expérience de l’IREDE et le travail de ses membres sur le phénomène des agences avec une Journée G. ISAAC en juin 2001, aboutissant à la publication des Actes de ce colloque dans la collection Etudes de l’IREDE, poursuivi en mars 2004 par un nouveau colloque consacré à une Agence nouvellement créée : l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), assorti d’une publication en 2005.
Face à l’inflation du nombre d’agences depuis quelques années, la diversification du phénomène dans l’ensemble des 3 piliers, la signification importante en termes de gouvernance européenne et le déficit d’engagement général administratif et financier, le programme PRAGUE s’est consacré à ces nouvelles sources d’intérêt.
Suite aux retards pris au niveau communautaire pour se doter d’un cadre juridique transversal pour les agences, le programme PRAGUE a démarré en 2009, suivi d’un colloque les 11 et 12 mars 2010.
Le programme comprend 4 axes :
- Une mise en perspective comparatiste
- L’identification d’un modèle européen d’agence significatif d’un droit administratif de l’UE en émergence en collaboration avec le Professeur E. CHITI de l’Université de Viterbo (Italie)
- Un bilan des agences, spécialement celles créées au début des années 2000 afin de mesure leur apport sur le plan contentieux, de la sécurité, ou des relations avec les Etats tiers.
- L’entreprise interinstitutionnelle actuelle consistant pour l’Union à se doter d’un cadre administratif et financier transversal pour ses agences, avec la contribution d’E. PARADIS, Directeur ressources à la Direction du budget de la Commission européenne
- NORMA – Etude de l’évolution des processus normatifs dans l’Union européenne
Le programme se donnait pour objectif d’étudier dans leur originalité, leur diversité et leur signification les processus décisionnels et normatifs au sein de l’Union européenne.
Chaque thème abordé est traité par un spécialiste. Ces contributions ont été regroupées et publiées dans un ouvrage collectif aux éditions Bruylant fin 2009.
Ont ainsi été traitées les thèmes suivants :
- Séparation des pouvoirs et prise de décisions dans l’UE, par T. GEORGEOPOULOS
- La fonction législative dans l’Union « modifiée », par C.BLUMANN
- Les évolutions de la majorité qualifiée au Conseil, par J.P. JACQUET
- Le Parlement européen législateur, par D.BLANC
- La méthode ouverte de coordination, palliatif ou substitut ?, par S. DE LA ROSA
- La prise de décision dans le troisième pilier, par M. GAUTIER
- La prise de décision dans le deuxième pilier, par F.TERPAN
- La prise de décision exécutive dans l’Union européenne, par J. JORDA
- La procédure de révision des traités, par H. GAUDIN
- La décision budgétaire, par J. MOLINIER
- La participation des Etats tiers à la prise de décisions dans l’Union européenne, par C. RAPOPORT
- POLONIUM
Les deux Etats concernés par la coopération envisagée connaissent, selon des modalités différentes, un certain nombre d’impositions assises, en partie ou spécifiquement, sur les biens immobiliers propriétés ou utilisés par les contribuables. Cette fiscalité, souvent désignée sous le terme de fiscalité immobilière, pose en France comme en Pologne, un certain nombre de difficultés de conception et d’application dont attestent les nombreuses réformes en cours aussi bien en France (réforme de la fiscalité de l’urbanisme, réforme des plus values immobilières, mise en place de taxes sur les cessions de terrains devenus constructibles…) qu’en Pologne. Par delà la diversité des impositions mises en place par chacun des Etats et/ou leurs subdivisions territoriales, cette fiscalité spécifique à la propriété immobilière pose un certain nombre de questions générales communes. Ces questions tout autant théoriques que pratiques touchent par exemple :
- aux modalités d’identification des propriétés immobilières, à la mise en place potentielle d’un « registre » permettant le récolement de ces informations, au contenu exact de « ce registre » et sa mise à jour ;
- au choix de la base imposable (valeur vénale du bien immobilier ou valeur administrée ?) et ses conséquences financières pour le bénéficiaire de l’impôt et ses implications en terme de contrôle ;
- à la technique fiscale retenue par le législateur pour mettre en oeuvre les choix précédemment opérés par chacun des Etats : type d’impôts (directs/indirects, sur le revenu des immeubles/sur le patrimoine), redevables (particuliers ou entreprises) , modalités de liquidations (exonération de certains biens, taux, etc.) et recouvrement. Ces questions générales concernent tant les impôts fonciers qui frappent les personnes physiques et que ceux qui frappent les entreprises.
En France comme en Pologne, la fiscalité des biens immobiliers utilisés par les entreprises a été attribuée aux collectivités locales au motif, généralement admis, qu’il est normal que l’imposition locale d’une l’entreprise repose au moins en partie sur l’immeuble ou les immeubles qu’elle occupe au titre de son implantation locale. Même si les modalités techniques de ces impositions diffèrent évidemment, les impôts fonciers locaux des entreprises doivent dans les deux Etats répondre, en temps de crise financière et budgétaire, à deux objectifs partagés et contradictoires : assurer en partie l’autonomie financière des collectivités infra étatiques concernées, et, en tant que charges fiscales imposées aux entreprises, constituer un critère non négligeable de l’attractivité d’un territoire pour des entités économiques potentiellement délocalisables. A ce titre, les réponses apportées aux questions générales que soulève l’appréhension de l’immeuble par la loi d’impôt sont et doivent être spécifiques lorsque le redevable est entreprise : l’affectation de l’immeuble à une activité professionnelle interdit ici une simple approche patrimoniale et justifie des solutions particulières non exclusivement justifiées par de préoccupations budgétaires.
Fortes de ces constats, et encouragées en cela par l’intérêt renouvelé pour la méthode comparatiste à l’appui de la gouvernance fiscale, les équipes universitaires concernées par le projet se proposent donc de mener une étude comparée des législations fiscales de la France et de la Pologne en matière de taxation, par les collectivités locales, des biens immobiliers des entreprises : elles espèrent identifier, par la confrontation des expériences nationales, un certain nombre de pratiques communes de nature à conforter les choix politiques et administratifs actuels, ou au contraire des pratiques divergentes susceptibles d’être source d’inspiration pour des réformes à venir.
Programme de travail proposé et calendrier
Vu l’importance du champ de recherche potentiel, il est envisagé de mener cette étude en deux temps :
La première année (année universitaire 2012/2013) serait consacrée en parallèle à :
- l’étude de la mise en place ou du perfectionnement des outils cadastraux à des fins fiscales dans chacun des Etats : la Pologne étant particulièrement intéressée par cette question dans la mesure où elle n’a pas encore d’instrument de récolement des biens immobiliers aussi perfectionné que la France. Pour la France, cette étude sera menée en collaboration avec les géomètres experts. Elle aura pour intérêt majeur de diffuser auprès du public des juristes un certain nombre de connaissances de nature extra juridiques indispensables à la bonne compréhension de notre fiscalité foncière, des liens de collaboration qu’elle implique entre les collectivités locales bénéficiaires de ces impôts et la DGFip, administration chargée de la gestion de l’impôt local. En Pologne, le choix de la centralisation de l’outil cadastral ne semble pas avoir encore été fait, et la comparaison permettra sans aucun doute de déterminer si une gestion plus locale de l’outil cadastral pourrait concilier efficacité économique et simplification administrative.
- l’étude comparée de la valeur retenue comme assiette des impôts fonciers locaux : Cette question est d’une particulière actualité en France puisque l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a décidé de la réforme de la réforme de la valeur locative cadastrale des biens professionnels avec mise en oeuvre définitive pour 2014. Mais alors que l’administration fiscale se dit, après expérimentation « in vivo » de la réforme sur quelques départements, prête à son application généralisée à l’ensemble du territoire, les difficultés politiques engendrées par les transferts de charges induits par ce changement de législation semble nécessiter une entrée en vigueur progressive de la réforme. De son coté le droit Polonais qui n’est pas exempt de tentative de réformes sur ce point, retient aujourd’hui, faute de mieux et au détriment peut être des collectivités locales,
une évaluation simplifiée des propriétés foncières fondée principalement sur la surface. Une analyse comparée de ces problématiques conduira sans aucun doute à déterminer quels sont les avantages et inconvénients de chacune des méthodes envisageables et à proposer des méthodes destinées à minimiser les difficultés politiques et économiques inhérentes à tout changement de législation en la matière.
Cette première année qui associerait universitaires fiscalistes et historiens du droit, géomètres experts, les spécialistes des questions fiscales cadastrales de la DGFip puisque Toulouse à la chance d’héberger le centre de formation des agents cadastraux de l’administration financière, se conclurait par une journée d’Etudes organisée dans les locaux de l’Université d’Olsztyn en juin 2013 et la publication d’un ouvrage bilingue récapitulant les différentes interventions.
La seconde année (année universitaire 2013/2014) plus spécifiquement fiscale étendra le champ de l’étude et sera consacrée à l’étude comparative des impôts fonciers locaux des entreprises. Par delà les aspects touchant à la question de la valeur fiscale donnée à l’immeuble qui auront en principe été traités lors de la période n°1 du projet, il s’agira d’identifier, dans la fiscalité foncière locale de l’Etat partenaire, les bonnes ou mauvaises pratiques, d’en identifier les déterminants et de s’appuyer sur ce retour d’expérience pour proposer des améliorations de notre droit national. Seront investies des questions aussi variées que : les pouvoirs normatifs des collectivités locales en la matière au regard des contraintes politiques, constitutionnelles et internationales, le choix entre propriété ou disposition du fait générateur de l’impôt, les exonérations sectorielles possibles ou souhaitables au regard des exigences d’équité entre contribuables.
- RESOC – Internormativité : la résolution des conflits de normes entre ordres juridiques différents
Le programme RESOC s’intéresse aux diverses situations dans lesquelles des normes appartenant à des ordres juridiques différents sont en conflit et les outils juridiques de résolution de ces conflits. L'Union européenne est porteuse d'un certain nombre de situations, qu'il s'agisse des relations verticales entre la norme communautaire et la norme nationale d'un Etat membre mais également des relations horizontales entre les normes nationales. Au-delà de l'Union, la question se pose évidemment entre les ordres juridiques nationaux mais également entre un ordre juridique national et l'ordre européen.
Il s'agit ainsi de distinguer ente les relations verticales entre les normes utilisant le critère de la hiérarchie pour donner une solution au conflit et les relations horizontales qui doivent trouver un autre critère. Le droit international privé constitue dans le cadre des relations horizontales l'un des outils par la proposition de règles de conflit de lois, mais lorsque l'Union européenne s'intéresse et organise les relations entre les normes des Etats membres, elle propose d'autres outils comme le principe de reconnaissance, lequel peut se traduire par l'application de la loi d'origine. La recherche de solutions aux conflits horizontaux passe sans doute aussi, et l'Union européenne développe largement cette méthode, par la coordination entre les différents acteurs sous forme de réseaux de juges ou d'autorités. L'approche économique fondant le droit de la concurrence devrait aussi conduire à s'interroger sur l'opportunité des outils de coordination retenus dans cette discipline dans le cadre en particulier de la construction de l'espace judiciaire européen.
L'analyse passe certes par la recherche de solutions en aval par une technique conflictuelle mais également par la recherche de solutions en amont. Ces solutions anticipant les conflits passent par l'élaboration d'un métalangage juridique, soit un langage matriciel à partir duquel des normes nationales sont prises, lesquelles normes se trouvent entre elles dans une relation d'équivalence. L'élaboration de ce métalangage est permis,dans les domaines déjà investis parles droits nationaux, par la méthode comparative utilisée pour élaborer des normes. C'est en particulier la technique de la directive, mais c'est également celle des lois types, des guides pratiques qu'une analyse des travaux de la CNUDCI a permis de mettre en évidence.
Ce programme a été dirigé par le Professeur S. PERUZZETTO avec les membres du LIEU, ainsi que le concours d’un réseau de juristes européens de droit international privé.
Il a donné lieu à un colloque à Toulouse en octobre 2008 « La matière civile et commerciale, vers un code européen de droit international privé ? ». Les contributions ont été rassemblées et publiées en juin 2009 chez Dalloz.
Le programme a également connu le succès de nombreuses publications collectives à la Semaine juridique - « Chronique de droit international et européen », et l’Encyclopédie Dalloz de droit communautaire sur l’espace de liberté de sécurité et de justice.
Enfin, deux membres de l’équipe entament une recherche dans un réseau coordonné par l’ Université de Louvain la Neuve en matière de droit international privé et de droit de la concurrence.
- MADCO
MADCO – Méthodologies appliquées de droit comparé
Le projet MADCO, piloté par le Centre de droit comparé, est axé sur les méthodologies appliquées au droit comparé.
Trois thèmes étaient proposés : la réception des droits occidentaux dans les traditions juridiques non-occidentales, la réception du droit religieux musulman dans les pays européens, l'interaction des traditions de civil law et de common law.
1. Macro-comparaison
- Un ouvrage collectif de 550 pages va être publié aux éditions L'Harmattan :
Droits maghrébins des personnes et de la famille : à l'épreuve du droit français.
Cet ouvrage a été rédigé grâce à une convention signée avec la Faculté de droit de Constantine. Il associe des professeurs français et maghrébins (algériens et marocains), des maîtres de conférence et de jeunes chercheurs, docteurs et doctorants.
Il envisage la réception des droits occidentaux au Maghreb et d'autre part les réactions françaises face au droit religieux musulman. Il contient des approches variées : droit des personnes et de la famille, droit du travail, droit public, droit international privé.
- Le thème de la comparaison franco-maghrébine a été approfondi par une Journée d'études organisée le 8 février 2008 sur un thème illustrant et cristallisant toutes les tensions liées ces questions : "Le couple mixte franco-maghrébin". Ce colloque, organisé conjointement par le Centre de Droit Comparé et les étudiants du Master 2 "Droit international & comparé" a donné lieu à la publication d'Actes aux "Cahiers de l'IRDEIC" en 2009.
2. Méso- et micro-comparaison – Mondialisation et répercussions sur les traditions juridiques occidentales
Le thème a pour objectif d'illustrer d'autres méthodologies mettant en exergue la nouvelle dimension du droit comparé dans ses relations avec le droit international et avec le droit européen.
- Cette problématique a été abordée au travers d'un sujet d'actualité et pluridisciplinaire, lors d'un colloque intitulé "Le médicament – Aspects de droit international, européen et comparé". Ce colloque formait la 2ème "Journée d'études du Master Droit International & Comparé", et a été organisé le 25 mars 2009. Les Actes en seront publiés.
- L'étude de ce thème se poursuivra par l'organisation d'un colloque sur le thème "Qu'en est-il de la simplification du droit ?". Ce colloque constituera les VII° Journées Annuelles de l'IFR "Mutations des normes juridiques" de l'Université Toulouse 1 – Sciences Sociales, les 26 et 27 novembre 2009.
Il s'agira d'une manifestation internationale faisant intervenir plusieurs des correspondants internationaux du Centre, tels que Michel van de Kerchove, un théoricien belge du droit de renommée internationale, Eleanor Ritaine, la directrice de l'Institut Suisse de Droit Comparé, Luigi Balestra, un professeur italien de droit privé comparé, ou encore Françoise Tulkens, professeur à l'UCL et juge à la CEDH.
L'argumentaire part d'un constat : les pays européens connaissent actuellement un effort sans précédent de "simplification" du droit et des techniques juridiques. Or, si ce thème est récurrent dans les discours sur le droit, la réalité de cette simplification soulève davantage de débats. Quelques travaux se sont déjà intéressés à des aspects limités de ce phénomène, mais en l'étudiant dans le cadre national français, et dans une perspective le plus souvent strictement disciplinaire. Or cette notion, d'abord confinée aux formalités administratives, a envahi la totalité des branches juridiques et toute l'activité normative française, internationale, communautaire. Ce colloque se propose d'aller au-delà de ces approches, afin d’examiner ce phénomène à la fois dans une perspective interdisciplinaire, afin de mieux cerner la notion et ses manifestations, et dans un cadre élargi à l'Europe, afin d'identifier des problématiques qui transcenderaient les manifestations nationales de cet effort de simplification du droit.
- "Les difficultés d'adaptation de la norme juridique : common law et droit continental face aux droits locaux dans l'Océan Indien – Inde, La Réunion, Madagascar, Mayotte et l'île Maurice" (IR3MA)
Ce projet développe le thème transversal des résistances à la circulation des concepts juridiques, dans l'examen des interactions de la civil law et de la common law. Les difficultés rencontrées dans cette région, et les solutions trouvées, sont de nature à guider l'Union européenne dans la gestion des frictions dues à l'introduction dans les systèmes juridiques nationaux de ses Etats membres de concepts juridiques issus ou inspirés de systèmes juridiques différents.
Ce phénomène est perceptible dans l'ensemble de l'Océan Indien, et sera étudié à partir des exemples de l'Inde elle-même, de Madagascar, de l'île Maurice, de Mayotte et de La Réunion.
La question de la traduction des concepts juridiques se pose en Inde en termes de rapports entre droits d'origine locale, droit d'origine britannique, droit d'origine française ou portugaise dans les anciens comptoirs. Ainsi, la common law s'applique telle qu'elle était à la fin du XVIIIème siècle, mais adaptée au contexte indien; les Cours supérieures utilisent la langue anglaise, et seules les juridictions inférieures se réfèrent à l'hindi ou à d'autres langues du sous-continent.
L'île Maurice, membre du Commonwealth, connaît un système de droit mixte associant droit continental (d'origine française) et common law.
A Madagascar, le système respecte les principes du droit continental, sous l'influence française, mais ils reçoivent une interprétation locale. De plus une proportion importante de droit coutumier subsiste. Une profonde transformation est cependant en cours, notamment dans les branches du droit qui concernent le plus directement l'activité économique, sous l'influence de la common law.
Mayotte, collectivité d'outre-mer française, deviendra un département en 2011. Cela ne résout pas les difficultés qui résultent du "statut personnel" des Mahorais, dérogatoire au Code civil et à certains principes de la République, comme celui de la laïcité…
Quant à La Réunion, elle applique un droit continental, le droit français, mais connaît également des adaptations aux influences de systèmes juridiques étrangers.
Cette étude permettra d'associer juristes, sociologues et linguistes. Elle s'appuiera également sur les contacts noués par le CDC, notamment avec l'Université Nehru de New-Delhi.
- EQFI – Recherche autour de la notion d’Equité fiscale
Pour mener à bien cette étude collective, le parti a été pris de laisser à chacun le choix d’une question qui lui semblait avoir un rapport avec la définition ou la mise en œuvre d’un principe ou d’un concept d’équité en matière fiscale. Cette démarche a conduit à la liste des contributions qui suivent et dont on peut penser d’une part qu’elles ne couvrent pas systématiquement l’ensemble de la matière fiscale et d’autre part qu’elles sont bien disparates. Pour autant, la collection des contributions individuelles, devrait être parachevée par la rédaction d’une introduction collective en la forme d’une synthèse dans laquelle les auteurs tenteront de faire un portrait commun de la notion. Les contributions sont les suivantes : - BOUBAY PAGES Michèle : Les aides fiscales aux entreprises dans le cadre de l’aménagement du territoire et l’équité fiscale : - CHASTAGNARET Manuel : Equité fiscale et taxation du bénéfice des entreprises : études comparatives des modalités d’imposition de taxation du travail et de celle du capital. - Vincent DUSSART : La TVA est-elle un impôt équitable ? - De FONTAINE Sophie : de la notion d’équité fiscale dans les décisions rendues sur les recours pour excès de pouvoir contre les refus de remise gracieuse (article 247 du L.P.F.). - MOLINIER Joël : Le principe d’équité fiscale dans la jurisprudence de la CJCE - QUEROL Francis : Equité fiscale et mécanisme de la retenue à la source. - RUEDA Frédérique : La place de l’équité fiscale dans les travaux de l’OCDE - SEBASTIEN Gilles : Vers la naissance d'instruments fiscaux internationaux d'équité : l'exemple de la taxe de solidarité sur les billets d'avion dite taxe Chirac. – Nicolas TILI : Equité fiscale et redevance télévision : le cas français à l’aune des expériences européennes D’autres contributeurs ont été sollicités en externe comme Eloi DIARA et Augustin TORRES. Un ouvrage collectif a été publié en 2009 et devrait faire l’objet d’une dédicace en l’hommage de Monsieur le Professeur G . Tournié.